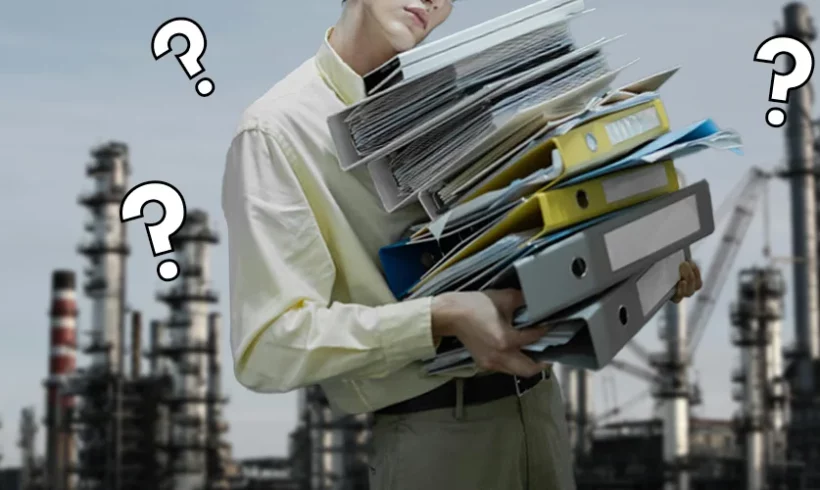Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.
La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?
Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).