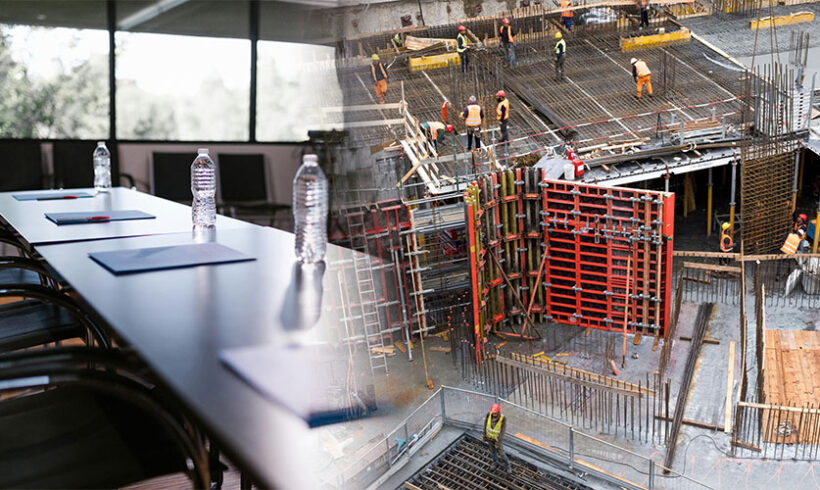Ne constitue pas un trouble « anormal » la perte d’ensoleillement en zone urbaine (Cass, 29 sept.2015)
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans un arrêt en date du 29 septembre 2015 (C.cass, 29 septembre 2015, n°14-16729), la Cour de cassation estime que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage la construction de logements dans le voisinage dans la mesure où la perte d’ensoleillement n’excède pas le risque encouru du fait de l’installation en milieu urbain.
En l’espèce des particuliers avaient assigné une société qui avait édifié sur une parcelle voisine de leur propriété deux bâtiments de 16 logements en réparation d’un trouble anormal de voisinage qui étaient caractérisé par une perte d’intimité et d’ensoleillement.