L’invocabilité de la trajectoire climatique en contentieux de l’autorisation environnementale
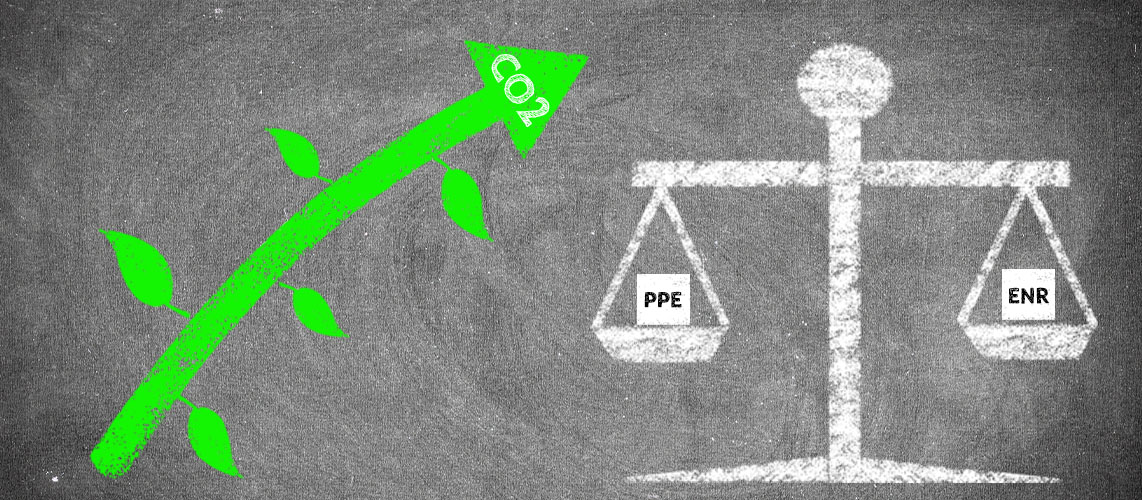
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Depuis la décision très remarquée du Conseil d’État Grande-Synthe (voir notre commentaire de CE, 1er juillet 2021, n° 427301 : Lebon.T.), la valeur juridique des objectifs climatiques fixés par la France a suscité de nombreux débats.
La Haute juridiction a reconnu l’inaction de l’État quant à ses engagements climatiques, notamment au regard de la stratégie nationale bas carbone (SNBC), tout en réaffirmant que ces objectifs n’étaient pas juridiquement, en eux-mêmes, contraignants.
Cette affaire, a ainsi ouvert la voie à une déclinaison des « carences fautives » dans des domaines d’application programmatique de la politique climatiques.
Cependant, une lecture plus engageante de véritables obligations climatiques conditionnant la mise en œuvre des polices administratives devait immanquablement être testée et invoquée devant des juridictions administratives.
In fine la question de l’opposabilité directe de la trajectoire climatique et l’érection d’une véritable obligation climatique a été posée à au moins deux reprises.
Elle a d’abord reçu une réponse favorable, pour le moins spectaculaire et symbolique, de la part du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane (voir notre commentaire de TA Guyane, 27 juillet 2021, n° 2100957), avec la suspension de l’autorisation environnementale Centrale du Larivot exploitée par EDF pour méconnaissance de la trajectoire climatique :
« le projet tel qu’autorisé par l’autorisation environnementale en cause ne peut toutefois, en l’état et compte tenu du taux d’émission annoncé, être regardé comme participant de manière suffisante à la trajectoire de réduction de ces émissions fixée par le décret susvisé du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du code de l’énergie de – 40 % en 2030 par rapport à leur niveau 1990 et de – 37 % en 2030 par rapport à leur niveau de 2005, fixé par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 ».
Ainsi saisi, le Conseil d’État va refermer immédiatement cette véritable boîte de Pandore, la Haute juridiction refusant de mettre en regard les autorisations environnementales avec leur contribution à la trajectoire climatique.
Le Conseil d’État a constaté qu’il n’y a pas lieu de confronter directement l’autorisation environnementale de la future centrale du Larivot à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui fixe à la politique énergétique nationale l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030.
Aucune disposition législative ne fait en effet de lien entre cet objectif de la politique énergétique nationale et les décisions individuelles délivrées au titre du code de l’environnement comme celle ici en cause.
La prise en compte de ces objectifs est en revanche prévue par le code de l’énergie pour une autorisation d’exploiter une centrale de production d’électricité. Il n’en va de même pour une autorisation délivrée au titre du code de l’environnement, que si elle vaut également décision d’exploitation au titre du code de l’énergie, comme le prévoit l’article L. 181-3 du code de l’environnement. Tel n’était pas le cas de l’autorisation en cause (voir notre commentaire de CE, 10 février 2022, n° 455465).
Dans ce contexte, une décision du tribunal administratif de Rouen (TA Rouen, 13 juin 2024, n° 2303382, téléchargeable sur Doctrine), met à nouveau en lumière les limites et les subtilités de l’opposabilité et de la portée juridique des trajectoires climatiques.
Dans cette affaire, l’autorisation préfectorale contestée permettait l’exploitation d’un terminal méthanier flottant dans le port du Havre, projet soutenu par Total Energies LNG Services France.
Les requérants, notamment l’association Écologie Pour Le Havre, faisaient valoir que cette autorisation allait à l’encontre des objectifs climatiques définis par l’article L. 100-4 du code de l’énergie et de la SNBC, à savoir :
« Il résulte des dispositions précitées que le contrôle » de la trajectoire » relatif à la mise en œuvre des objectifs fixés notamment par les accords de Paris concerne l’émission globale de gaz à effet de serre. Il n’implique pas que l’acte attaqué soit illégal du seul fait qu’il prévoit des émissions de gaz à effet de serre. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté contesté, des dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ni des stipulations de l’article 2 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc), relatives aux objectifs de la politique énergétique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état des données scientifiques exposées, ni n’est allégué par les requérants que l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (GES) concernant un projet générant au maximum de sa capacité 228 530 tonnes de CO2 annuel, aurait pour objet ou pour effet, à elle seule, de faire obstacle à la réalisation des objectifs mentionnés par les dispositions précitées. ».
Ainsi, bien que les trajectoires climatiques ne soient pas contraignantes, elles ne sont pas pour autant dépourvues de toute portée juridique.
En effet, si une décision administrative, comme une autorisation d’exploitation, compromettait à elle seule, de manière significative la réalisation des objectifs climatiques, elle pourrait être contestée sur cette base.
Dans le cas du terminal méthanier flottant, le tribunal a estimé que, bien que le projet génère des émissions de gaz à effet de serre, il n’était pas établi que ces émissions, à elles seules, empêcheraient la France de respecter ses objectifs climatiques.
Cette approche des juges introduit une nuance intéressante par rapport aux décisions antérieures qui se sont montrées plus rigides quant à la non-opposabilité des trajectoires climatiques.
D’ailleurs, cette démarche trouve un ancrage au final dans la jurisprudence de principe du Conseil d’État lorsque un opérateur éolien a invité la Haute juridiction à annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre et la ministre de la Transition énergétique sur sa demande du 14 avril 2023, tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles permettant à la France d’assurer la compatibilité de la trajectoire du développement des énergies renouvelables sur le territoire national, afin d’atteindre l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 et l’objectif de 42,5 % dans la consommation énergétique globale.
Certes, la Haute juridiction va rejeter au fond le recours, mais c’est en rappelant que :
« le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée » (décision commentée : CE, 6 novembre 2024, n° 471039 : Lebon T, point 10).
Et cette précision n’est d’ailleurs pas uniquement propre au contentieux climatique. Pour une mesure à édicter en droit des étrangers, on retrouve la même formulation (CE, 27 novembre 2019, n° 433520) .
Reste que cette approche administrativiste paraît bien inadaptée à l’avènement d’une justice climatique qui serait susceptible d’annuler les autorisations environnementales contribuant au dérèglement climatique. En effet, soit que l’autorisation de police n’existe pas (transport maritime hyper émetteur), soit que le cumul des autorisations délivrées caractérise de fait le seuil d’atteinte à la trajectoire climatique.
Au demeurant, le Conseil d’État ne semble pas non plus enclin à renforcer son contrôle sur la suffisance de l’adaptation de la réglementation à la trajectoire lorsqu’elle se fait trop ambitieuse. Il s’évertue alors à la neutraliser : saisi par un opérateur éolien et l’association Énergies renouvelables pour tous, les magistrats du Palais-Royal ont estimé :
« Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les objectifs fixés à l’article 3 du décret arrêtant la programmation pluriannuelle de l’énergie, relatifs à la contribution des différentes sources d’énergies renouvelables à la production d’électricité en France, et qui ne traduisent que des options hautes et basses, présenteraient un caractère contraignant à l’égard de l’État. Par suite, il ne peut utilement être soutenu que les décisions attaquées méconnaîtraient ces objectifs » (décision commentée : CE, 6 nov. 2024, n° 471039, point 20).
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :














Laissez un commentaire