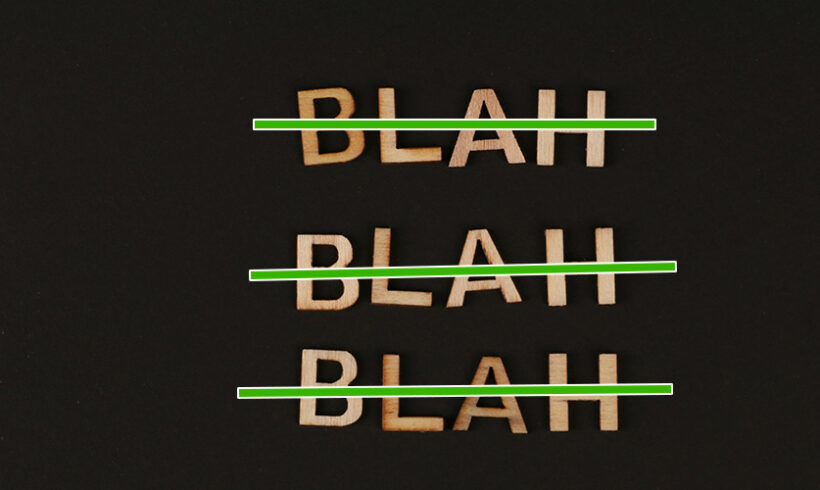Le CERFA de demande d’autorisation environnementale est en vigueur
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Aux termes de l’article D181-15-10 du code de l’environnement (Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 – art. 2) et issue de la réforme de l’autorisation environnementale, « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de demande d’autorisation ».
Un arrêté du 28 mars 2019 fixe le modèle national de la demande d’autorisation environnementale, publié au JO n°0136 du 14 juin 2019 (texte n° 4).
L’usage de ce nouveau formulaire CERFA n° 15964*01 (téléchargeable ici) : pour la constitution du dossier de demande d’autorisation environnementale devient obligatoire depuis le 15 juin 2019, soit le lendemain de la date de publication de l’arrêté.