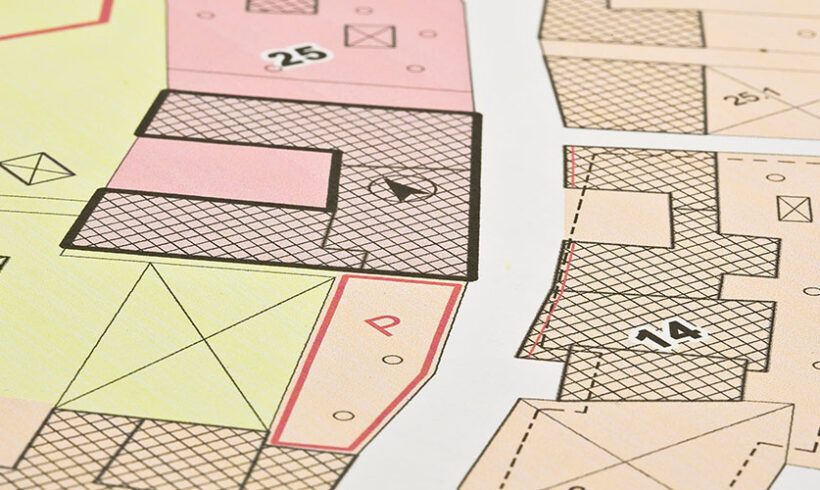
Illégalité pour vice de procédure d’une délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) : précisions sur l’application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme (CE, 23 déc.2014)
Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats)
En novembre 2014, le Conseil d’Etat avait admis que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne faisait pas obstacle à ce que l’irrégularité d’un document d’urbanisme soit invoquée au-delà d’un délai de six mois après son adoption lorsqu’il n’est pas encore devenu définitif (voir notre analyse ici).
Aux termes d’une décision du 23 décembre 2014, le Conseil d’Etat affine son interprétation des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme en examinant une nouvelle situation et en adoptant alors une lecture assez restrictive de cet article (Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 23 décembre 2014, n°368098, mentionné dans les tables du recueil Lebon).








