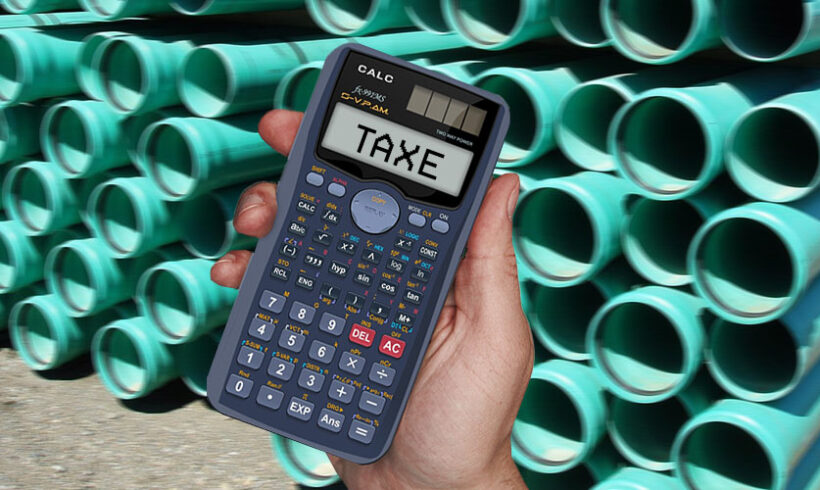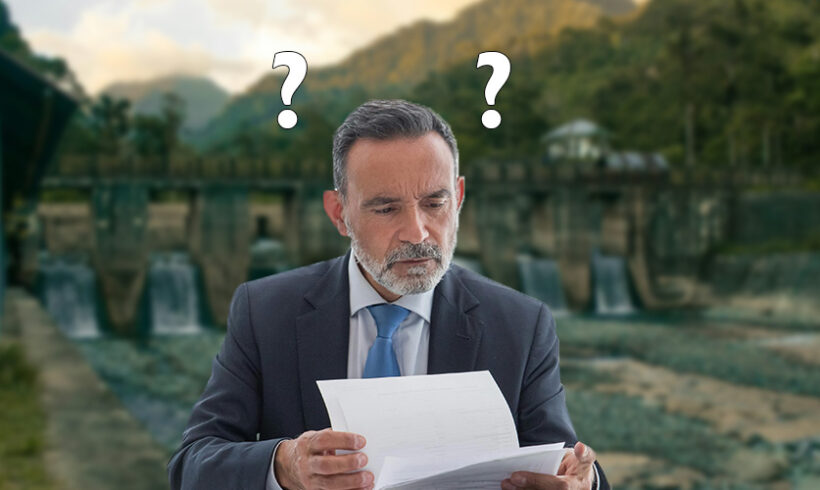Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.
Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.
L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?
Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :
« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).