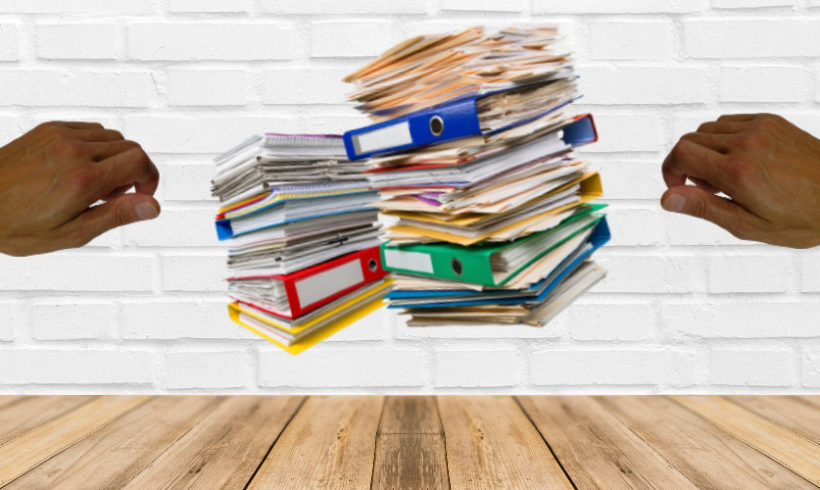
Sursis à statuer sur la légalité de l’autorisation d’exploitation de l’usine Rockwool
Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Le tribunal administratif d’Amiens a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2021 du préfet de l’Aisne autorisant la société Rockwool France à exploiter une usine de fabrication de laine de roche située sur le territoire des communes de Ploisy et Courmelles, et a enjoint à l’administration dispose d’un délai de quatre mois pour régulariser le vice de procédure relevé par les juges, tenant à une insuffisance dans l’étude d’impact (TA d’Amiens, nos 2102663 et 2102680, 21 juillet 2023, téléchargeable ci-dessous).








