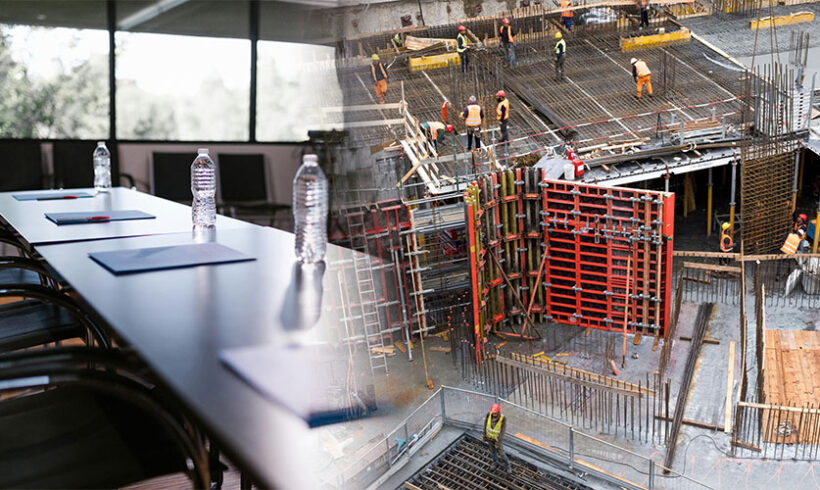Eolien/Prise illégale d’intérêts : Personne ne peut contourner la prescription pas même le ministère public! (Cass12 nov.2015)
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
Dans un arrêt en date du 12 novembre 2015 (C.cass, 12 novembre 2015, n°14-83.073), la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel ayant condamné des élus pour recel de prise illégale d’intérêts.
En l’espèce, deux conseillers municipaux, poursuivis initialement du chef de prise illégale d’intérêts, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir recelé des sommes d’argent versées annuellement, correspondant au montant des locations de parcelles leur appartenant et supportant des fermes d’éoliennes dont l’installation avait reçu l’avis favorable du conseil municipal auquel ils ont participé.