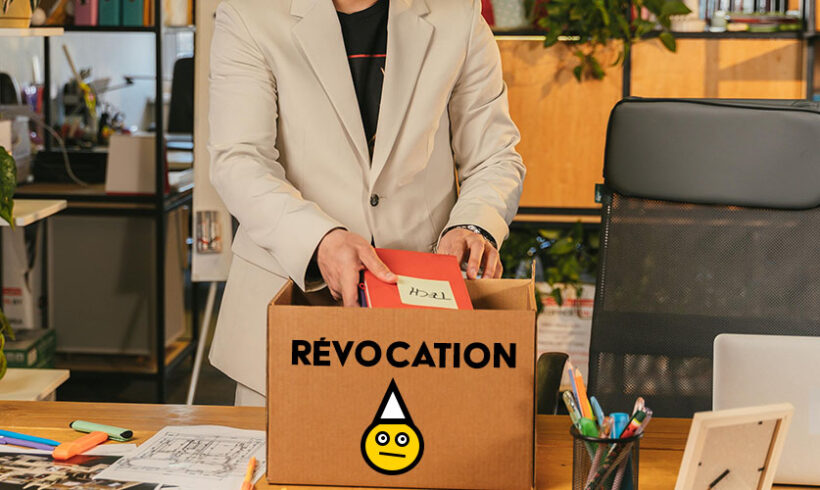
Fonction publique : révocation d’un agent pour son manque de rigueur et d’implication
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 6 décembre 2022, le Président de la communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France a pris un arrêté de révocation à l’encontre de Monsieur D, lui reprochant notamment son manque de rigueur et d’implication.
Le manque de rigueur et d’implication reproché à un agent dans ses fonctions est-il suffisant pour prononcer sa révocation ?
Le Tribunal administratif de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative, mettant ainsi en exergue l’importance de l’intérêt général et du sens du service public dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique en général, en fonction du poste occupé et des conséquences d’un manquement à certaines obligations d’un fonctionnaire (décision commentée : TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2301494 ).








