Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Le 18 avril 2025, le sénateur Adel Ziane et plusieurs de ses collègues ont déposé au Sénat le texte n° 543 rectifié relatif à la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs.
L’article 1er de ce texte vise à davantage encadrer, aux termes de la loi, la liberté académique, corollaire du principe à valeur constitutionnelle d’indépendance des enseignants-chercheurs, et à protéger les sources et matériaux des chercheurs et des enseignants-chercheurs. L’article 2 vise à garantir la mise en œuvre effective de la liberté académique dans chaque établissement d’enseignement supérieur, en instaurant l’obligation d’adopter une politique d’établissement formalisée, assortie d’un bilan annuel.
En 2019, deux maîtres de conférences, Caroline Regad et Cédric Riot, ont organisé un colloque intitulé « La personnalité juridique de l’animal (II) Les animaux liés à un fonds » à la Faculté de droit de l’Université de Toulon, les 28 et 29 mars 2019, avec le parrainage de la Fondation Brigitte Bardot. Ils ont demandé au Professeur Julien Dubarry, Agrégé en droit privé et sciences criminelles de cette Université, de participer à ce colloque et d’en faire la synthèse en vue de la publication d’un ouvrage.
La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.
Le Professeur Dubarry les a donc assignés devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu’ils soient condamnés à transmettre sa synthèse à l’éditeur en vue de sa publication et à réparer son préjudice.
Le 17 octobre 2019, le tribunal judiciaire a rejeté ces demandes. Le demandeur a donc interjeté appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, demandant désormais une réparation pécuniaire de 1 000 €, dans la mesure où les actes du colloque avaient fini par être publiés sans sa contribution.
Le 6 juillet 2023, la Cour d’appel a rejeté à son tour ces demandes. Le Professeur s’est donc pourvu en cassation.
La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?
La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à la liberté d’expression, dispose que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Deux problèmes juridiques peuvent ici être mis en exergue.
Première question : les deux maîtres de conférences, responsables scientifiques de l’ouvrage, ont-ils abusé de leur liberté d’expression, c’est-à-dire de leur liberté éditoriale, en refusant de publier le rapport de synthèse ?
A cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative :
« Aux termes de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. Cependant, ce texte ne constitue pas une loi, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la convention, permettant de restreindre la liberté d’expression.
Il s’ensuit que, si le refus d’insérer une contribution dans un ouvrage publié à la suite d’un colloque est susceptible de heurter les traditions universitaires et les principes d’objectivité et de tolérance, il ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme abusif » (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522, points 13 et 14 ).
Deuxième question : dans la mesure où les deux libertés en présence avaient la même valeur normative, la Cour de cassation aurait-elle dû les mettre en balance ?
Là aussi, la réponse de la Cour est négative mais peu justifiée :
« En l’absence d’atteinte à la liberté d’expression de M. Dubarry résultant d’un refus de transmettre sa contribution à l’éditeur, la cour d’appel n’avait pas à procéder au contrôle de proportionnalité invoqué » (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522, point 17) .
Cet arrêt est très intéressant, dans la mesure où, pour une fois, ce n’est pas une atteinte verticale à la liberté d’expression académique qui est mise en exergue, mais des rapports horizontaux entre deux maîtres de conférences et un Professeur. De plus, le conflit est beaucoup plus doctrinal que juridique : alors que le colloque avait pour ambition de promouvoir l’intégration dans l’ordonnancement juridique français du concept de personne physique non humaine au profit des animaux, le demandeur a, dans le rapport de synthèse non publié, exprimé son désaccord avec la solution juridique proposée. D’où la décision de non publication.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :






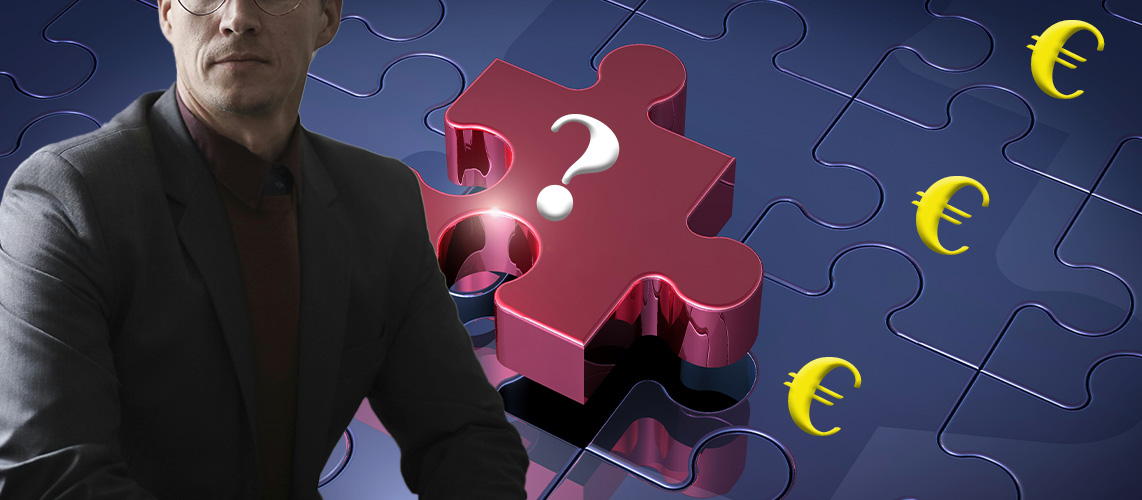








Laissez un commentaire