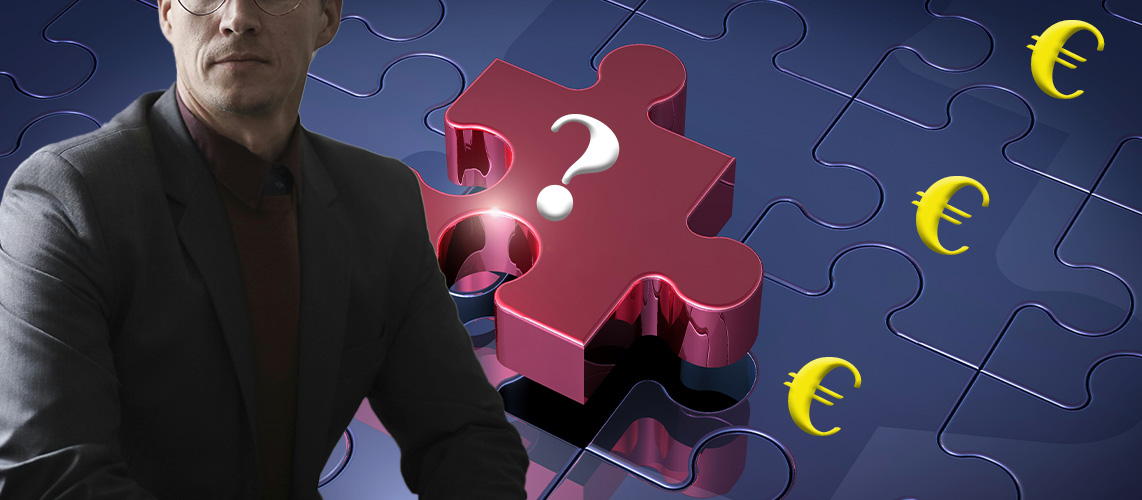Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
À partir du milieu des années 1970, cherchant à reproduire les Agences nord-américaines, la France a créé des Autorités qui, sans disposer de la personnalité juridique, cessaient d’être soumises au pouvoir hiérarchique. La première Autorité à avoir été instituée sur ce modèle a été le Médiateur de la République, désigné comme Autorité indépendante par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République. Cependant, l’expression « Autorité administrative indépendante » a été utilisée pour la première fois par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour désigner la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui a pour rôle de contrôler le traitement des informations nominatives, notamment au moyen de l’informatique.
Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.
Le 11 mars 2025, ces deux sociétés ont chacune saisi le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité : elles affirmaient que les articles 19 et 22 de la loi du 6 janvier 1978 n’étaient pas conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans la mesure où ils ne prévoyaient pas, pour la personne faisant l’objet d’une procédure de sanction par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’information préalable du droit qu’elle a de se taire.
D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.
Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?
Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).
En revanche, la question de la conformité à la Constitution de l’article 19 de cette même loi n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.
Qu’il s’agisse de l’article 19 ou de l’article 22, ces articles organisent l’enquête administrative menée par les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et précisent notamment le statut du rapport sur la base duquel des sanctions peuvent être prises.
Quant à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il est toujours bon de rappeler qu’il dispose que :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
Dans un premier temps, le Conseil d’État a donné son analyse de l’article 19 :
« En premier lieu, les dispositions de l’article 19 de la loi du 6 janvier 1978, relatives aux pouvoirs d’enquête de la CNIL sont en principe mises en œuvre avant l’engagement d’une procédure de sanction. Elles n’ont en outre pas pour objet le recueil, par les enquêteurs de la CNIL, des explications d’une personne portant sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause dans le cadre d’une procédure tendant à l’adoption de mesures de sanction à son encontre. Dans ces conditions, elles n’impliquent pas par elles-mêmes que les personnes sollicitées soient préalablement informées du droit qu’elles auraient de se taire. Par suite, la question soulevée par les sociétés Cosmospace et Télémaque, en tant qu’elle porte sur cet article 19, laquelle n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel » (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596, point 6 ).
Dans un second temps, il s’est prononcé sur l’article 22 :
« En second lieu, les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, relatives à l’exercice du pouvoir de sanction de la CNIL, sont applicables au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. L’appréciation du grief tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution suppose, notamment, de déterminer si l’obligation pour une autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction d’informer les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence s’applique aux personnes morales et, dans l’affirmative, selon quelles modalités. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés requérantes, en tant qu’elle porte sur cet article 22, présente ainsi un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel » (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596, point 7 ).
À titre de rappel, trois conditions sont nécessaires au dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité : d’abord, il faut que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou qu’elle constitue le fondement des poursuites dans le cas d’une affaire pénale. Ensuite, la deuxième condition est que la disposition contestée n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Enfin, il faut que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas manifestement infondée.
Après avoir consacré le droit de se taire pour les personnes physiques, c’est à nouveau au Conseil constitutionnel d’appréhender ce même droit, cette fois-ci pour les personnes morales.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :