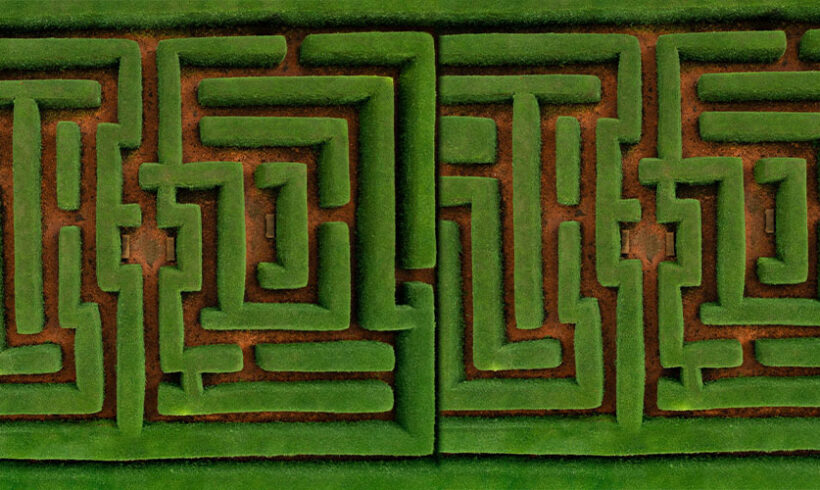Focus sur l’action en démolition
Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Une récente décision du conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n°2020-853 QPC du 31 juillet 2020) justifie que l’on fasse un point sur l’action en démolition pour non-respect des règles d’urbanisme, dans la lignée d’une excellente synthèse faite sur le site du Conseil à l’occasion de son commentaire. Le respect des règles d’urbanisme est assuré par plusieurs mécanismes pouvant conduire à la démolition des ouvrages construits en méconnaissance de ces règles. Seul le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, a le pouvoir d’ordonner la démolition d’une construction privée. Une telle démolition peut être prononcée tant par le juge répressif que par le juge civil. I/ Le juge répressif peut ordonner la remise en état ou la démolition En application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des règles d’urbanisme est constitutive d’une infraction pouvant être punie d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire. En cas de condamnation, l’article L.480-5 du même code permet au juge pénal d’ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu ou la démolition des ouvrages ou encore la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le délai de prescription applicable à cette action pénale a été porté à six ans par la loi n°2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. II/ L’action civile en démolition en cas d’annulation du permis ouverte aux tiers intéressés Une action civile en démolition est ouverte, en application du 1°de l’article L. 480-13, contre le propriétaire d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire annulé par le juge administratif. Ici un tiers lésé qui devra se prévaloir d’un préjudice personnel en relation directe avec la violation des règles de l’urbanisme (), pourra saisir le juge judiciaire afin qu’il ordonne au propriétaire de démolir sa construction édifiée conformément à un permis de construire annulé définitivement par juge administratif il y a moins de deux années. Mais d’autres conditions sont requises pour que l’action puisse conduire au prononcé de la démolition du juge judiciaire : une règle d’urbanisme ou une servitude d’utilité publique doit avoir motivée l’annulation par le juge administratif et la construction doit être est située dans l’une des catégories de zones énumérées protégées au sens de la Loi Macron, présentant un enjeu particulier de protection de la nature et des paysages, de sites sensibles ou du patrimoine architectural et urbain. Il s’agit plus précisément des zones suivantes énumérées au 1° de l’article L480-13 du code de l’urbanisme : « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L. 122-9 et au 2° de l’article L. 122-26, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ; b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ; c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ; e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ; f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ; g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ; i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ; k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des…