Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.
Actuellement, cette prescription est régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : elle intervient en principe pour les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le sieur B est né le 18 novembre 1946.
Au sein de la Banque de France, il a exercé les fonctions de directeur régional.
En 2007, une décision a porté l’âge limite du personnel de direction de 63 à 65 ans et a permis au gouverneur d’organiser les modalités transitoires de ce relèvement.
À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.
Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450 ) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.
Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.
Il a donc saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de licenciement et à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de l’illégalité de sa mise à la retraite dès l’âge de 63 ans.
Le 29 janvier 2021, le Tribunal a d’abord jugé que la Banque de France a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du requérant du fait de l’illégalité de la décision l’ayant placé d’office à la retraite à l’âge de 63 ans.
Ensuite, il a rejeté sa demande de versement d’une indemnité de licenciement en raison de l’inapplicabilité au litige de l’article L. 1237-8 du Code du travail.
Enfin, le Tribunal a fait droit à la demande indemnitaire en tant seulement qu’elle portait sur le versement d’une indemnité réparant son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031, en renvoyant le requérant devant la Banque de France pour le calcul et le versement de cette indemnité.
S’agissant d’une éventuelle créance antérieure au 14 mai 2014, le Tribunal l’a déclarée atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.
La Banque de France a interjeté appel contre ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Le 24 mai 2022, la Cour a rejeté l’appel de la Banque de France contre ce jugement en tant qu’il retenait que la créance du requérant correspondant à son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031 n’était pas atteinte par la prescription.
Le 25 juillet 2022, la Banque de France s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
L’intéressé s’est également pourvu en cassation contre cet arrêt.
Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).
D’une part, l’article 2224 du Code civil a prévu que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
D’autre part, l’article L. 1237-8 du Code du travail dispose que :
« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement. ».
Pour opérer ce revirement de jurisprudence, le raisonnement du Conseil d’État s’est décomposé en trois temps.
D’abord, la section du contentieux a évoqué les règles de prescription :
« D’une part, les règles de prescription des créances détenues sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d’un comptable public sont déterminées par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Aux termes de son article 1er : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Aux termes de son article 3 : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. » » (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060, point 6 ).
Ensuite, elle s’est référée au Code civil :
« D’autre part, les règles de prescription des créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d’un comptable public sont en principe prévues par le code civil. À cet égard, en vertu de l’article 2224 du code civil, cité au point 2, les actions personnelles ou mobilières engagées à leur encontre se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060, point 7 ).
Enfin, l’analyse de ces différentes règles aboutit à l’interprétation suivante :
« Pour l’application des règles de prescription mentionnées aux points 6 et 7, lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date » (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060, point 8 ).
Cela étant, Monsieur B ne peut pas prétendre être resté dans l’ignorance de sa créance jusqu’en 2017, date à laquelle le Conseil d’État a jugé illégales les mises à la retraite à 63 ans. Sa demande a donc été rejetée.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :






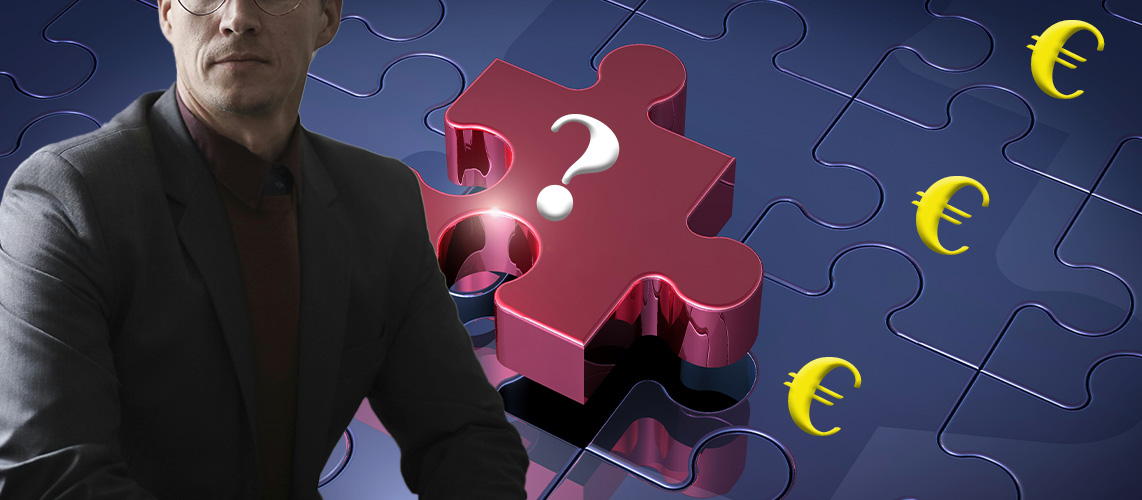









Laissez un commentaire