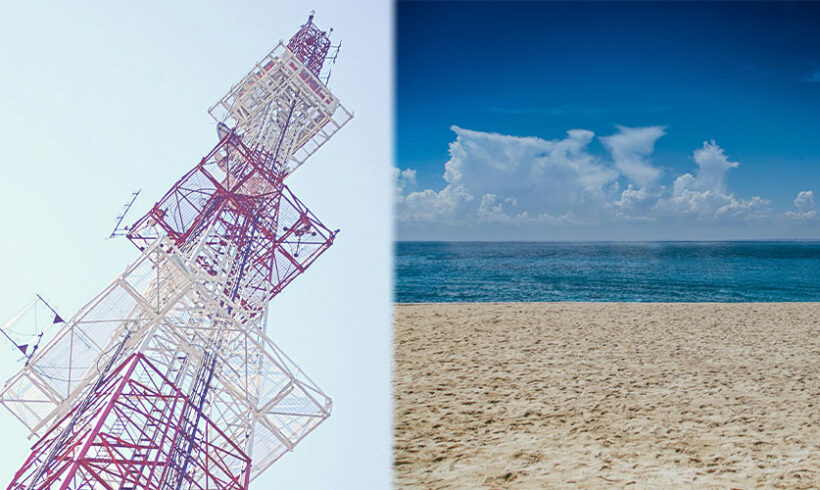Contentieux indemnitaire du PV urbanistique : compétence judiciaire
Par Maître Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats)
Aux termes d’une décision du 11 octobre 2021, le Tribunal des Conflits a décidé qu’un litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de l’établissement ou de la transmission d’un procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’autorité judiciaire relevait de la juridiction judiciaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable (TC, 11 octobre 2021, n° C4220, mentionnée aux tables du recueil Lebon, consultable ici).