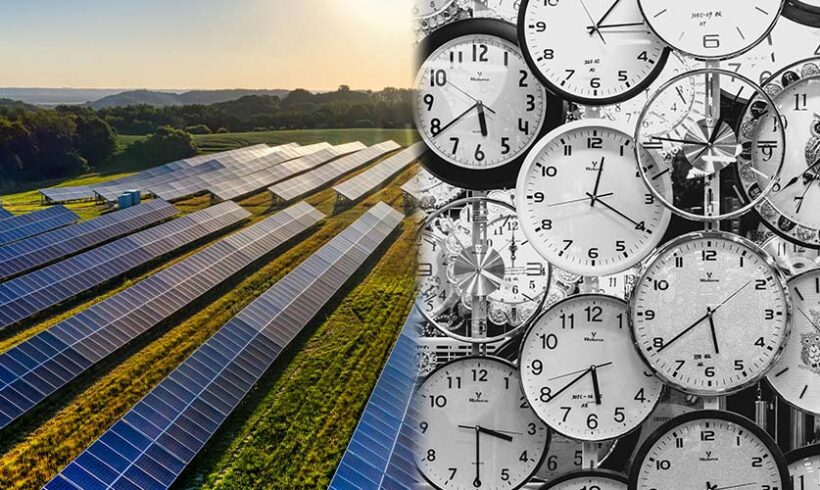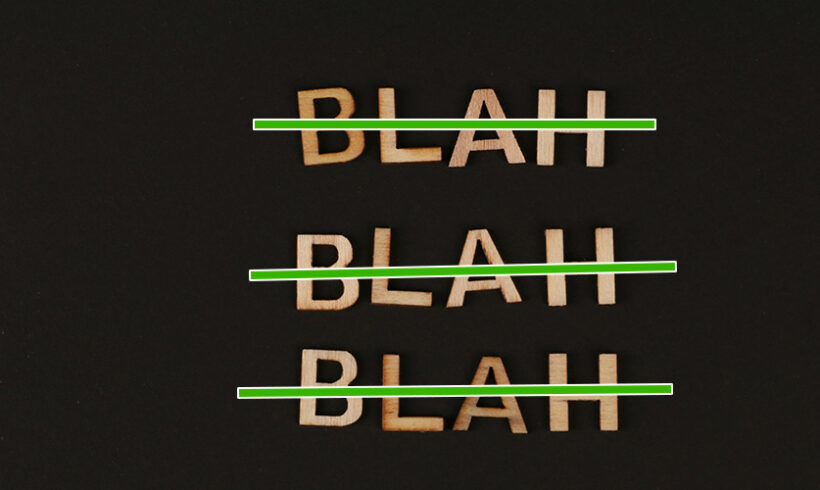Participation effective à l’évaluation environnementale
Par maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Il est parfois des décisions qui ne retiennent pas immédiatement l’attention… C’est bien le cas de l’un arrêt en date du 7 novembre 2019 rendu sur un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) qui voit la Cour préciser que la participation non-effective du public à l’évaluation environnementale fait échec à l’opposabilité du délai valant forclusion des recours engagés contre la décision autorisant le projet. En l’espèce, il était question d’un projet de création d’un complexe touristique sur une parcelle d’une surface d’environ 27 ha sur l’île d’Ilos (archipel des Cyclades, Grèce) qui s’étend elle-même sur une surface d’environ 100 km². Conformément à la législation grecque, un appel à participer à la procédure d’évaluation des incidences environnementales de ce projet a été publié dans le journal local de l’île de Syros (archipel des Cyclades, Grèce) ainsi que dans les bureaux de l’administration de la région Égée méridionale de la même île. Un an après, une décision des ministres de l’Environnement et de l’Energie et du Tourisme est venue approuver les exigences environnementales portant sur le projet. Mécontents de l’implantation d’un projet d’une telle envergure, plusieurs propriétaires de biens immobiliers sur l’île d’Ilos ont formé un recours contre cette décision plus de 18 mois après son adoption en justifiant n’avoir pu prendre connaissance de cette dernière qu’au début des travaux d’aménagement du site. Ce contentieux a été l’occasion pour l’équivalent grec du Conseil d’Etat de renvoyer à la CJUE deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite directive EIE. L’article 6 de cette directive prévoit que les informations relatives au projet soumis à évaluation environnementale doivent être transmises au public à un stade précoce des procédures décisionnelles en la matière par des moyens de communication appropriés. Quant à l’article 11, il évoque notamment le fait que les Etats membres doivent déterminer à quel stade les décisions peuvent être contestées. En ce qui concerne le droit hellénique, les dispositions nationales prévoient que le processus préalable à l’approbation des conditions environnementales se déroule au niveau de la région et non pas de la municipalité concernée, et que la publication sur Internet de l’approbation d’un projet fait courir le délai pour introduire un recours en annulation ou tout autre voie de droit. Ce délai est de 60 jours. Partant, la juridiction de renvoi a souhaité savoir si les dispositions de la directive EIE s’opposent à ces modalités de participation du public. En réponse à la première question, la Cour rappelle que l’article 6 de la directive EIE réserve expressément aux États membres le soin de déterminer les modalités précises, tant de l’information du public concerné, que de sa consultation du public. Cependant, la Cour émet plusieurs réserves s’agissant de la procédure en cause. D’abord, elle souligne que les autorités doivent s’assurer que les canaux d’information utilisés soient propres à atteindre les citoyens concernés afin de leur permettre de connaître les activités projetées, le processus décisionnel et leurs possibilités de participer en amont de la procédure. En l’espèce, les juges considèrent qu’un affichage dans les locaux du siège administratif régional, situé sur l’île de Syros, soit à une distance de 55 milles marins de l’île d’Ilos, bien qu’assorti d’une publication dans un journal local de cette première île, ne semble pas contribuer de façon adéquate à l’information du public concerné. Enfin, le dossier contenant les informations relatives au projet doit être mis à disposition du public de manière effective, c’est-à-dire dans des conditions aisées qui rendent possible l’exercice de leurs droits. Elle indique donc qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si de telles exigences ont été respectées en tenant compte notamment de l’effort que le public concerné doit fournir pour avoir accès au dossier ainsi que de l’existence d’une « charge administrative disproportionnée » pour l’autorité compétente. En l’espèce, la Cour relève que la liaison entre Ilos et Syros n’est pas quotidienne, dure plusieurs heures et n’est pas d’un coût négligeable. Au regard de ces éléments, les juges considèrent que l’article 6 de la directive EIE « s’oppose à ce qu’un État membre conduise les opérations de participation du public au processus décisionnel afférentes à un projet au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente, et non au niveau de l’unité municipale dont dépend le lieu d’implantation de ce projet, lorsque les modalités concrètes mises en œuvre n’assurent pas un respect effectif de ses droits par le public concerné, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier ». La seconde question découle de la première et conduit la Cour à juger que quand le public n’est pas mis à même de participer de manière effective à l’évaluation environnementale d’un projet, il ne peut se voir opposer un délai de recours contre la décision l’autorisant. On imagine un peu ce que cette affirmation de principe peut impliquer pour les audits bancaires et pré-contentieux des projets exposés à un tel risque… la purge constatée du délai de recours devra être doublée une analyse très serrée des formalités d’information du public afférentes à l’évaluation environnementale. Dans un premier temps, elle rappelle qu’il appartient aux Etats membres de fixer les délais de forclusion des recours. A cet égard, elle admet que les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la date à laquelle la personne concernée a pris connaissance de la décision. En revanche, ce délai ne saurait s’appliquer si le comportement des autorités nationales a eu pour conséquence de priver totalement la personne de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales. Tel est le cas en l’espèce. En effet, en l’absence d’information suffisante sur le lancement de la procédure de participation du public il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas s’être informé de la publication de la décision d’autorisation sur le site Internet de l’administration. Dès…