Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Dans sa décision du 8 décembre 2023, M. Renaud N (n° 2023-1074 QPC), le Conseil constitutionnel a étendu le droit de se taire à toute procédure de sanction ayant le caractère d’une punition, y compris aux sanctions administratives. Un an plus tard, le Conseil d’État a précisé comment acclimater cette nouvelle garantie au droit public (Conseil d’État Section 19 décembre 2024, M. A. B, n° 490157).
Alors que le principe du droit de se taire a été entériné par le Conseil constitutionnel et précisé par le Conseil d’État, ce dernier vient d’apporter d’autres précisions quant à son champ d’application, dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’Université.
Le 13 juin 2024, la Présidente de l’établissement Nantes Université a saisi le Président de la section disciplinaire du conseil académique de cette Université de poursuites disciplinaires engagées à l’encontre d’une étudiante inscrite en deuxième année de licence de droit pour l’année universitaire 2024-2025, pour des faits commis en novembre 2023.
Le 24 juillet 2024, le Président de la section disciplinaire a notifié ces poursuites à l’intéressée.
Le 10 septembre 2024, l’étudiante a été convoquée à la séance au cours de laquelle la commission de discipline devait examiner son affaire, fixée au 27 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement Nantes Université, compétente à l’égard des usagers, a exclu cette étudiante pour une durée de neuf mois.
L’étudiante a d’abord saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision.
D’après la requérante, la procédure n’avait pas été respectée, et elle n’avait pas été informée de son droit de se taire.
Le 13 novembre 2024, son référé suspension a été rejeté, au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de discipline.
Le 29 novembre 2024, l’étudiante s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?
Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).
L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que :
« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
D’une part, le Tribunal a rejeté la faute simple dans l’édiction des mesures des sanctions administratives :
« Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère punition. Elles impliquent que l’usager d’une université faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire » (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277, point 6).
Le juge administratif précise ensuite le champ d’application du droit de se taire :
« Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires de l’usager avec les agents de l’université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l’usager de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où l’usager d’une université, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l’éducation, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. » (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277, point 7).
La Haute Juridiction liste enfin les erreurs commises par l’Administration.
D’une part, lorsque le Président de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université a notifié par courrier ces poursuites à l’intéressée, ledit courrier ne lui précisait pas qu’elle avait la faculté de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, alors que tout usager d’une Université qui fait l’objet de poursuites disciplinaires doit être informé de ce droit dès la notification des griefs formulés à son encontre, conformément à l’article R. 811-27 du Code de l’éducation.
D’autre part, dans la mesure où la convocation du 10 septembre 2024 a été adressée à l’étudiante par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2024 et présentée le 19 septembre 2024, l’intéressée a été privée du délai de quinze jours lui permettant de préparer sa défense, prévu à l’article R. 811-31 du Code de l’éducation, puisque la séance a eu lieu le 27 septembre 2024, soit huit jours après la présentation.
L’étudiante en droit n’a donc pas été informée de son droit de se taire, elle n’a pas été informée de la faculté qu’elle avait de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, et elle n’a pas bénéficié du délai de quinze jours pour préparer sa défense.
C’est ce qu’on appelle un intéressant passage de la théorie à la pratique.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :






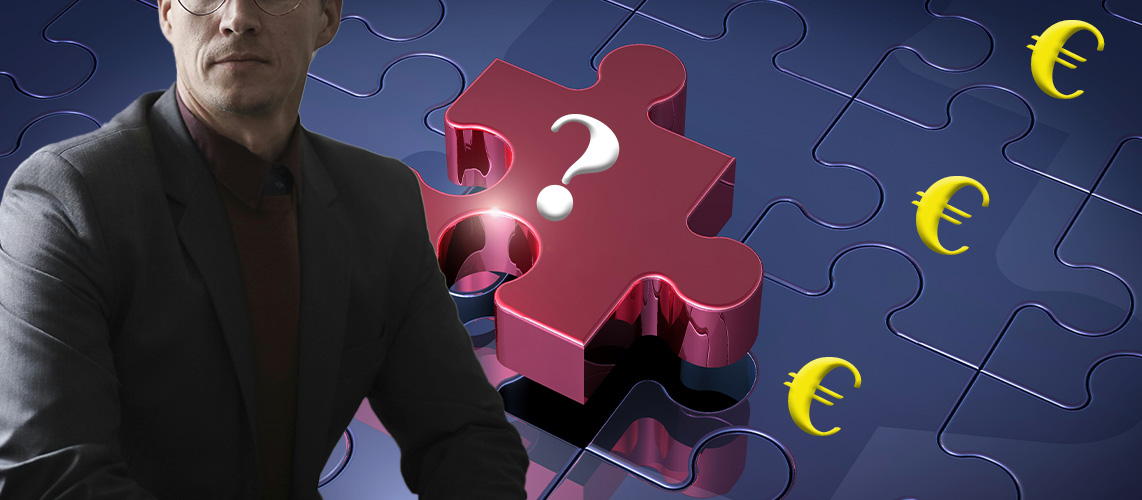








Laissez un commentaire