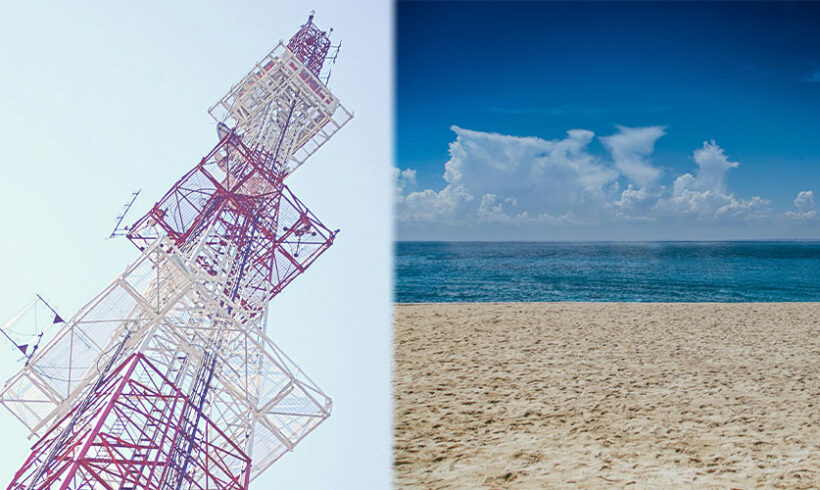Stocamine : l’Etat piégé par le défaut des capacités techniques et financières !
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
La Cour administrative d’appel de Nancy par la décision du 15 octobre 2021 (décision commentée : CAA Nancy, 15 octobre 2021, Collectivité européenne d’Alsace, Association Alsace nature, Association consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, n° 19NC02483, 19NC02516, 19NC02517) a annulé l’arrêté du 23 mars 2017 autorisant la société des mines de potasse d’Alsace (MDPA) à maintenir pour une durée illimitée un stockage souterrain de déchets dangereux dans le sous-sol de la commune de Wittelsheim.
Un retour sur cette décision qui a fait l’objet d’un pourvoi de l’État s’impose.