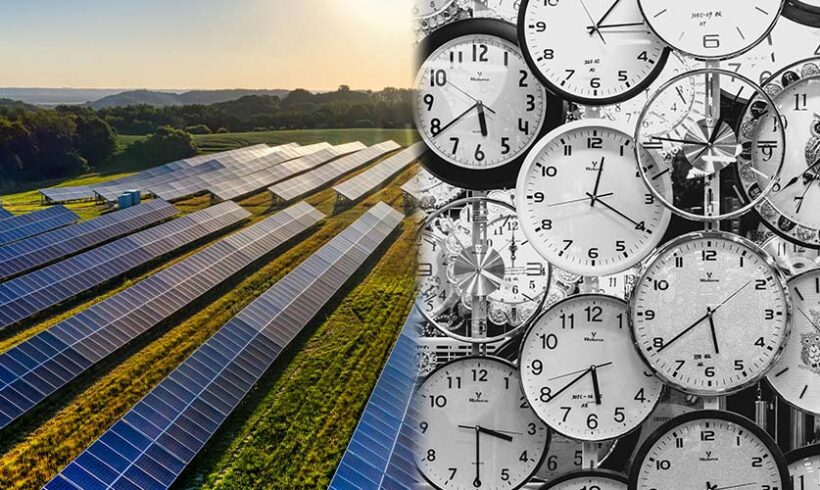Preuve de la consistance légale du droit fondé en titre
Par Maître Théo DELMOTTE, avocat (Green Law Avocats)
La détermination de la consistance légale des ouvrages fondés en titre fait très souvent l’objet d’intenses débats contentieux, et ce malgré les éclairages de la jurisprudence sur la méthode à employer.
Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX01403 – jurisprudence cabinet) fait application de l’état du droit sur ce sujet, et procède à une utilisation intéressante des rapports d’expertise, souvent diligentés par les exploitants et l’administration pour déterminer la consistance légale d’un ouvrage fondé en titre.