Droits fondamentaux : condamnation de la France pour contrôle au faciès

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
En droit des libertés fondamentales, la notion d’égalité et la notion de non-discrimination sont souvent présentées de concert. Pourtant, elles ne sont pas synonymes.
Alors que la notion d’égalité renvoie à une mesure des relations humaines visant à déterminer s’il existe une égalité dans la jouissance des droits des individus, le droit à la non-discrimination peut être compris comme l’expression juridique concrète et pragmatique de ce principe d’égalité, le moyen d’en assurer l’effectivité en énonçant précisément les motifs de discrimination interdits et les situations précises dans lesquelles de telles différences de traitement seraient prohibées.
Entre 2011 et 2012, six ressortissants français d’origine africaine ou nord-africaine ont fait l’objet de contrôles d’identité qu’ils qualifiaient de profilage racial ou contrôle au faciès. L’un d’entre eux a subi trois contrôles en l’espace de dix jours, dont deux la même journée.
Le 2 mars 2012, ces six ressortissants ont adressé un courrier au ministre de l’Intérieur, afin d’obtenir communication des motifs des contrôles dont ils avaient fait l’objet.
Le 16 mars 2012, le ministère a répondu à chacun d’entre eux que la Direction générale de la police nationale allait être saisie, afin de réaliser un examen approprié de la situation.
Le 11 avril 2012, aucune suite n’ayant été donnée à leur demande, les requérants ont assigné l’Agent judiciaire de l’État et le ministre de l’Intérieur devant le Tribunal de grande instance de Paris, afin d’engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice sur la base de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le 2 octobre 2013, par six jugements concernant chacun des six requérants, le Tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs demandes.
Chaque requérant a interjeté appel du jugement le concernant.
Le 24 juin 2015, par six arrêts, la Cour d’appel de Paris a confirmé les jugements du Tribunal de grande instance.
Les requérants se sont pourvus en cassation contre les arrêts de la Cour d’appel.
Le 9 novembre 2016, par six arrêts, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des requérants.
Le 9 mai 2017, les six requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme.
D’après les requérants, ces contrôles auraient été effectués en violation de l’article 14 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu’ils auraient été effectués pour des motifs raciaux et auraient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.
La France a-t-elle fait preuve de discrimination envers les requérants dans le cadre de contrôles d’identité ? Les faits concernant les requérants constituent-ils un traitement discriminatoire ?
La Cour européenne des droits de l’homme a répondu à ces questions par l’affirmative, mais pour un seul des requérants, reconnaissant donc que l’État français a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à ces contrôles (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17 ).
D’une part, l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
D’autre part, l’article 8 de cette même Convention dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Dans un premier temps, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, dans cinq cas de contrôle d’identité, les requérants n’ont pas apporté de commencement de preuve :
« La Cour considère que dans les cinq contrôles d’identité examinés ci-dessus, qui reposaient tous sur au moins une base légale identifiée, les requérants n’ont pas apporté de commencement de preuve individualisé d’un traitement différencié à l’aide d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants à même de créer une présomption de traitement discriminatoire. La Cour ne peut donc pas considérer que le seuil d’exigence nécessaire à la caractérisation d’une présomption en faveur de la thèse selon laquelle les contrôles d’identité (fouilles et palpations comprises lorsqu’elles ont eu lieu) ont été effectués pour des motifs discriminatoires a été atteint » (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17, point 122 ).
Dans un second temps, la Cour a jugé différemment le cas du sixième requérant :
« La Cour, s’écartant sur ce point de l’appréciation des juridictions internes, considère que bien que le requérant n’ait pas expressément invoqué un quelconque groupe de comparaison qui aurait été traité différemment lorsqu’il a été contrôlé, et même si les autres personnes qui l’accompagnaient ont également fait l’objet d’un contrôle d’identité, l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus entourant les trois contrôles (…), dont l’un a été réalisé en dehors de toute base légale, combinées à la fois entre elles et avec les rapports et données statistiques officiels dénonçant l’existence de cas de profilage racial dans les contrôles d’identité en France (…), constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à créer une présomption de discrimination. À ce titre, la Cour précise qu’elle considère que l’expression « tiens le 22 » prononcée par le requérant en guise de provocation à l’occasion du premier contrôle du 1er décembre 2011, a pu attirer l’attention des policiers, mais que les réponses apportées par l’un d’eux « viens voir on va le contrôler celui-là il fait son malin » et « on connaît vos codes de cités » (…) lui apparaissent stigmatisantes et déplacées » (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17, point 127 ).
C’est la première fois que la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour un contrôle d’identité discriminatoire.
Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :






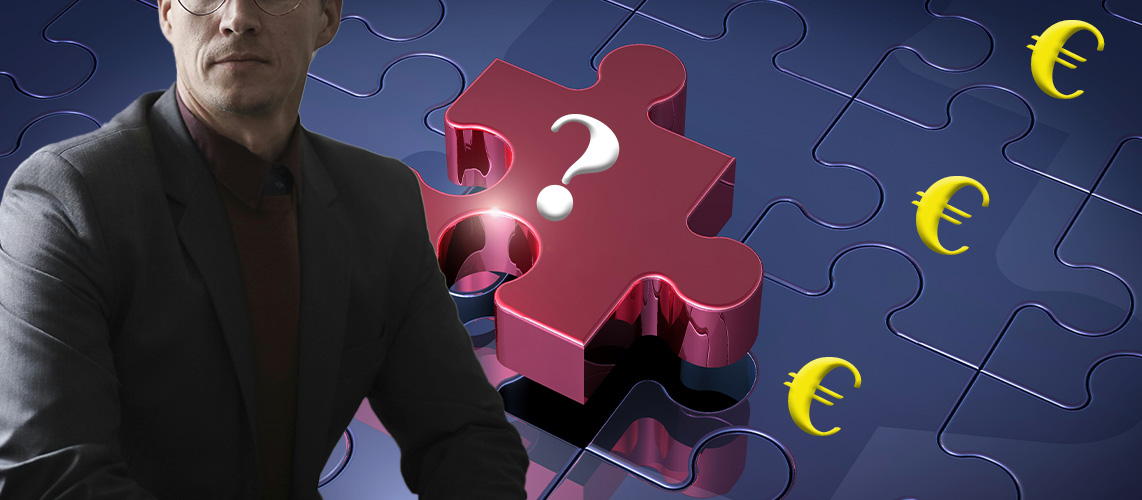








Laissez un commentaire