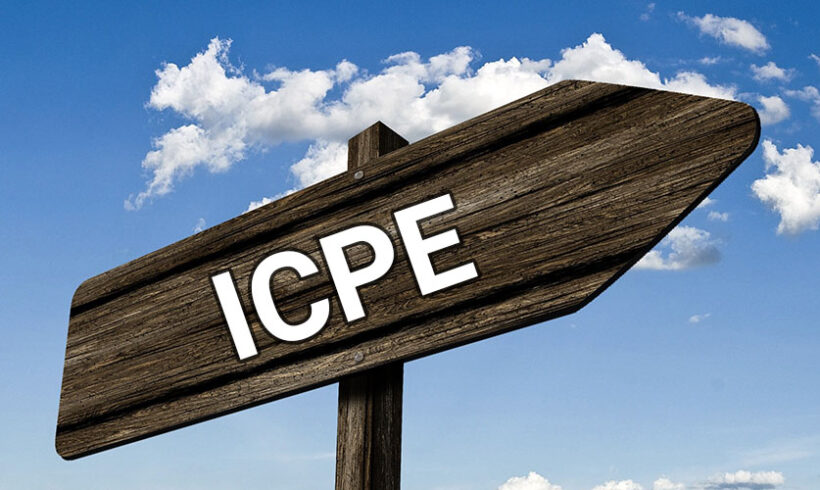CEE : Plusieurs fiches d’opérations standardisées sont modifiées
Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Un arrêté ministériel du 18 décembre 2020 a été publié au Journal Officiel du 30 décembre 2020 (JORF n°0315). Ce texte vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie. Rappelons ici que les opérations standardisées d’économies d’énergie sont des opérations d’économies d’énergie fréquemment réalisées. Des valeurs forfaitaires de certificats d’économie d’énergie (CEE) ont donc été fixées pour ces opérations au travers de fiches pour faciliter leur réalisation et le calcul des économies d’énergies. Ces fiches se répartissent en six secteurs d’activité : l’agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l’industrie, le réseau et le transport. Elles décrivent les conditions permettant d’obtenir la délivrance des CEE qui leur correspondent et les montants d’économies d’énergie forfaitaires qui y sont liés. L’arrêté 18 décembre 2020 révise six fiches d’opérations standardisées : Opérations « Isolation des toitures terrasses » (BAR-EN-105) ; Opérations « Fermeture isolante » (BAR-EN-108) ; Opérations « Chaudière biomasse individuelle » (BAR-TH-113) ; Opérations « Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles » (IND-UT-131) ; Opérations « Récupération de chaleur fatale pour valorisation vers un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) (RES-CH-108) ». Ces cinq dernières fiches s’appliquent aux opérations engagées au 1er avril 2021. La sixième fiche modifiée, correspondant aux opérations « Wagon d’autoroute ferroviaire » (TRA-EQ-108), entre en vigueur rétroactivement pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2020. L’arrêté 18 décembre 2020 crée également une nouvelle fiche d’opérations standardisées : « Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur » (BAR-SE-107). Cette fiche s’applique aux opérations engagées à compter du 31 décembre 2020. Pour mémoire, par plusieurs arrêtés ministériels du 8 octobre 2020 (NOR: TRER2027123A, NOR: TRER2027155A et NOR: TRER2027118A) plusieurs fiches d’opérations standardisées avaient déjà fait récemment l’objet de modifications.