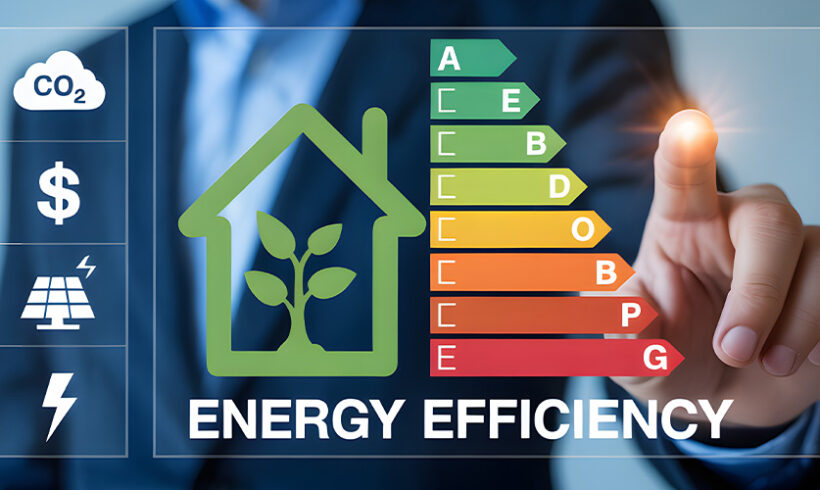
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : une révision des fiches en discussion pour la préparation du vingt-huitième arrêté en la matière
Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)
L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) est chargée de mettre en œuvre des groupes de travail sectoriels de professionnels. En résumé, ils sont chargés d’identifier les opérations d’économies d’énergie qui pourraient être standardisées, de déterminer les critères techniques et administratifs nécessaires et les économies d’énergie engendrées pour une opération donnée et d’élaborer les projets de fiches. Ces projets sont ensuite soumis à l’expertise de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME). Ils sont, enfin, approuvés par la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) avant d’être arrêtées par le ministre chargé de l’Energie, et publiées au Journal officiel de la République Française.
L’actuel catalogue des fiches d’opérations standardisées en vigueur résulte d’un arrêté du 22 décembre 2014 et publié au Journal Officiel le 24 décembre 2014. L’ATEE a récemment proposé à la DGEC la révision de six fiches et la création de 14 nouvelles fiches pour le prochain arrêté en la matière.








