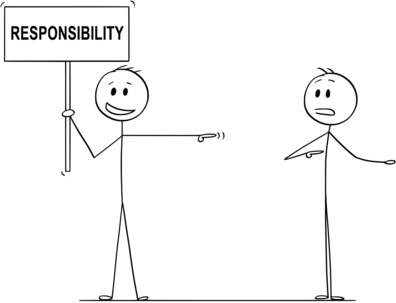Devoir de vigilance : conditions de recevabilité des actions en injonction précisées
Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)
Depuis le 27 mars 2017, le législateur a introduit un devoir de vigilance en droit des sociétés à l’article L. 225-102-4 du code de commerce pour lutter contre les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement.
Ces mêmes dispositions énoncent que le juge judiciaire peut être saisi par toute personne ayant un intérêt à agir afin d’enjoindre les sociétés à exécuter leurs obligations conformément à leur devoir de vigilance.
Pour autant, les conditions de recevabilité de cette action en injonction, en particulier l’appréciation de l’intérêt à agir des demandeurs, n’ont été précisées par la jurisprudence judiciaire que très récemment.
C’est pourquoi nous traiterons dans ce nouveau podcast des trois décisions de la cour d’appel de Paris en du 18 juin 2024 (RG n° 21/22319, RG n° 23/10583, RG n° 23/14348) délimitant l’office du juge de la mise en état dans le contentieux du devoir de vigilance.