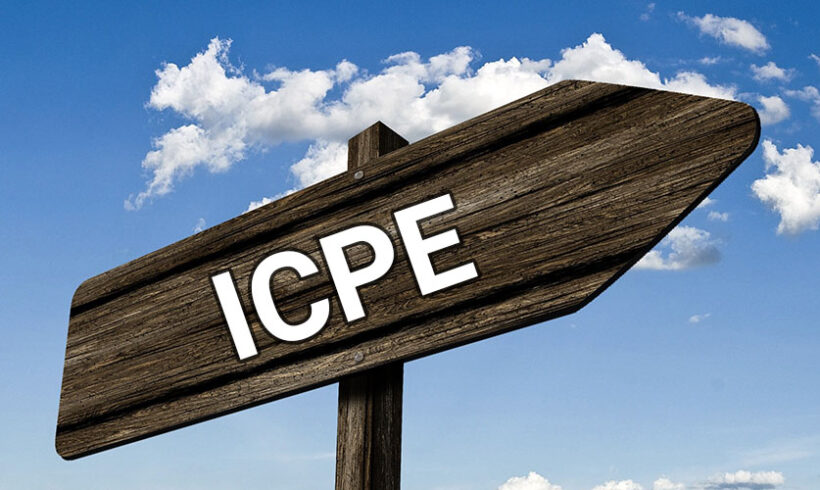Fraude aux CEE : pas de retrait du nouveau compte détenteur
Par un jugement avant dire droit n° 1802640 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de la Société ayant acquis des certificats d’économie d’énergie (CEE) tendant à l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en date du 28 juin 2018 prononçant leur retrait, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en sollicitant un avis contentieux.
Le Conseil d’État répond dans un avis rendu le 24 février 2021 n°447326 (téléchargeable ici) que le second détenteur de certificat d’énergie ne peut pas se les voir annuler en raison de la fraude commise par leur premier détenteur.