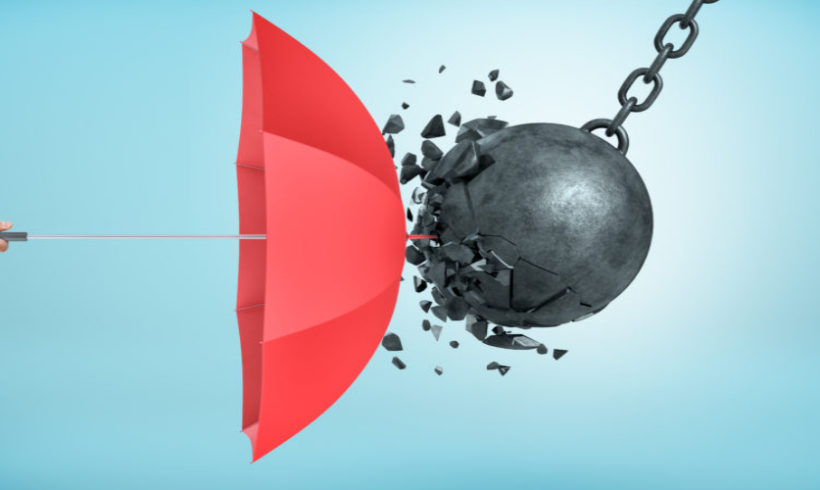
Protection fonctionnelle des élus locaux : qui l’accorde et quand ?
Par Maître David DEHARBE, Avocats associé gérant, spécialiste en droit public (Green Law Avocats) Dans un jugement récent (TA Lille, 12 Octobre 2021, n° 1909928) le Tribunal administratif a annulé une décision du 28 juin 2019 de la métropole européenne de Lille accordant la protection fonctionnelle à son président et ordonné sous trois mois à l’E.P.C.I. de récupérer les sommes versées pour le conseil du chef de son exécutif. Certes, il n’est pas contestable qu’en vertu de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), applicable au président et vice-présidents ayant reçu délégation des établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l’article L. 5211-15 du même code : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Reste que le le Tribunal administratif de Lille rappelle à la Métropole européenne de Lille (MEL) que le conseil communautaire, organe délibérant de la MEL, demeure, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle d’un élu local (cf. CAA Versailles, 20 déc. 2012, Cne de Servan, no 11VE02556 : AJDA 2013.1497, chron. Agier-Cabanes et CAA Marseille, 14 mars 2014, Cne de Marsillargues, no 12MA01582) et, d’autre part, qu’il n’y a poursuites pénales qu’à compter de la mise en œuvre de l’action publique. Or en l’espèce non seulement la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président de la Métropole, nullement habilité à cette fin ; mais, de surcroît, c’est à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police mais sans déclenchement de poursuites que la protection fonctionnelle avait été accordée au président par son premier vice-président.






